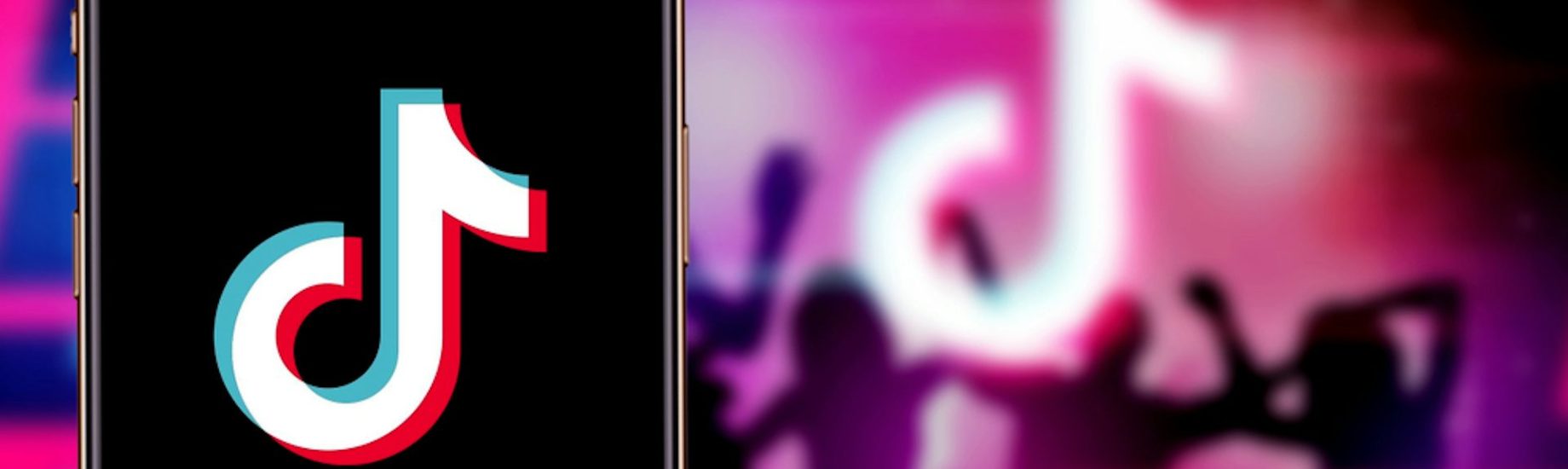Jeudi 11 septembre 2025, la commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok chez les mineurs a rendu son rapport, alertant sur l’un « des pires réseaux à l’assaut de la jeunesse ». Plateforme la plus prisée par les jeunes, qui y passent en moyenne cent dix minutes par jour, TikTok s’appuie sur un modèle économique conçu pour capter l’attention et renforcer la dépendance de son audience, afin de maximiser ses revenus.
Si plus de 75 % de ses recettes proviennent encore de la publicité, les achats intégrés sur TikTok s’affichent désormais comme un levier de croissance majeur pour le réseau social : en France, ils ont représenté près de 80 millions d’euros en 2023, contre 52 millions en 2022. Ces achats in-app permettent notamment aux jeunes d’acheter des cadeaux virtuels pour les offrir à leurs créateurs de contenus favoris pendant les lives. Roses, donuts, lions, ou encore ballons de rugby : les cadeaux seront ensuite convertis en diamants, puis en argent réel, moyennant une commission de la plateforme.
Ce système particulièrement lucratif tant pour TikTok que pour les streamers transforme les directs en véritables courses aux cadeaux, où les jeunes spectateurs sont sans cesse poussés à la dépense. Quelles stratégies sont déployées pour attirer leur attention et stimuler les dons ?
Nos recherches, menées à partir de l’observation de 40 lives TikTok de créateurs français pendant une période de trois mois, montrent que la plateforme intègre dans ses fonctionnalités de nombreux leviers issus de l’univers des jeux en ligne.