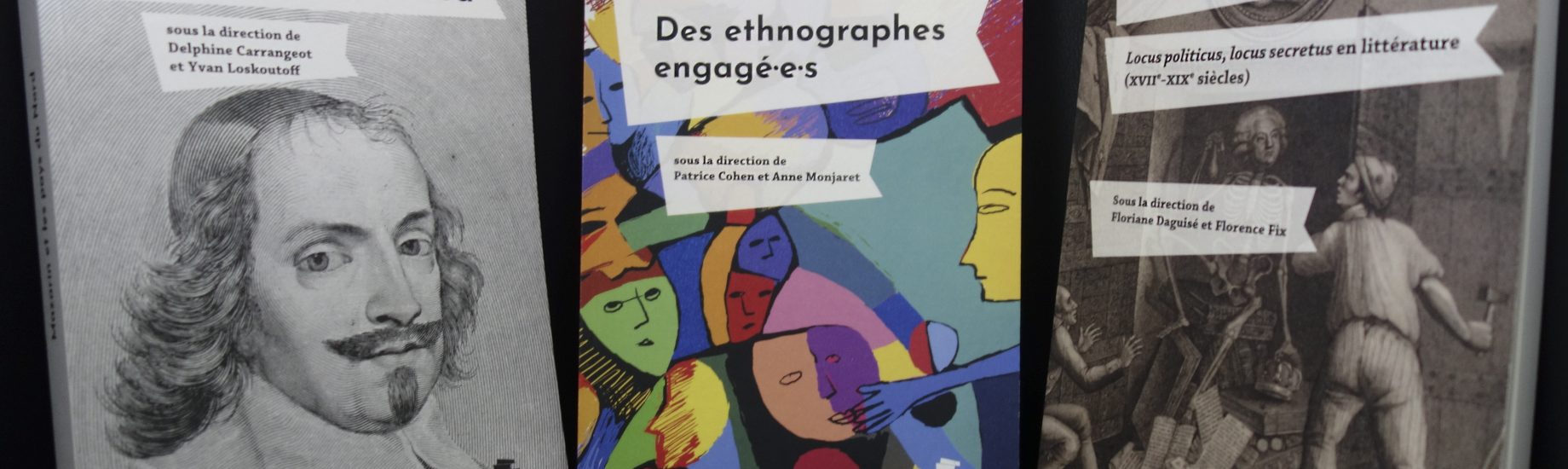
Les publications des PURH – novembre 2025
Les Presses universitaires de Rouen et du Havre sont heureuses de vous présenter leur actualité ! Trois ouvrages hors collection ponctuent ce mois de novembre : Dissimuler pour mieux régner. Locus politicus, locus secretus en littérature (XVIIe-XIXe siècles) explore les lieux secrets du pouvoir dans de célèbres fictions ; Des ethnographes engagé·e·s nous plonge dans les coulisses de la recherche et des enquêtes en sciences humaines et sociales et Mazarin et les pays du Nord étudie les relations du cardinal avec l’Europe nordique en politique, mais aussi dans les arts et la culture. Enfin, la webtv des PURH reprend du service ! De nouvelles interviews d’auteurs, autrices, directeurs et directrices d’ouvrages sont à découvrir.
Dissimuler pour mieux régner. Locus politicus, locus secretus en littérature (XVIIe-XIXe siècles)

L’ouvrage
La fin de l’Ancien Régime voit disparaître les privilèges attachés à l’exercice d’un pouvoir puissamment hiérarchisé, ce qui laisse à penser que le fait politique se déploie alors selon des modalités plus transparentes et horizontales. Pour autant, l’imaginaire d’un pouvoir opaque, usant de cabinets dérobés et d’espaces interdits demeure, et les contre-pouvoirs mobilisent tout autant sociétés secrètes, mots de passe, masques et rendez-vous cachés. Par-delà les soubresauts politiques, de la Révolution à la Restauration, de la Monarchie à l’Empire et à la République, le pouvoir tend à s’enraciner dans le secret, dans des confidences, mais aussi, au sens le plus concret du terme, dans des espaces confidentiels où s’exerce une autre forme d’autorité. Les chapitres de ce volume mettent au jour les lieux secrets de célèbres fictions de Rousseau, Balzac ou Zola, des récits de voyage et des pièces de théâtre comme autant de lieux politiques, c’est-à-dire où se décide, s’exerce ou échoue l’action politique.
Les directrices du volume
Floriane Daguisé enseigne la littérature française du xviiie siècle à l’université Rouen Normandie. Ses recherches portent sur l’esthétique de la première moitié du siècle, sur le renouvellement du genre romanesque et sur l’histoire des idées et des représentations, en lien avec la curiosité. Ses travaux ont par ailleurs exploré la catégorie de rococo et les rapports entre texte et image (illustration de Don Quichotte ou des Contes de La Fontaine).
Florence Fix enseigne la littérature générale et comparée à l’université de Rouen Normandie. Ses travaux portent sur les arts de la scène, en lien avec l’histoire culturelle et les enjeux de société de la fin du xixe siècle en Europe du Nord. Elle a publié notamment L’Histoire au théâtre, 1848-1870 (PUR, 2010) et Barbe-Bleue et l’esthétique du secret (Hermann, 2014).
- Dissimuler pour mieux régner. Locus politicus, locus secretus en littérature (xviie-xixe siècles), sous la direction de Floriane Daguisé et Florence Fix, PURH, 208 p., 14 €, ISBN : 979-10-240-1887-4.
Des ethnographes engagé·e·s
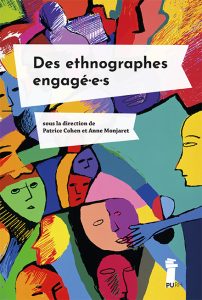
L’ouvrage
Quelles sont les formes d’engagement dans la pratique ethnographique ? Une vingtaine d’ethnographes de différentes sciences sociales et générations présentent leurs expériences. Des régimes d’engagement sont ainsi discutés, à l’échelle d’un terrain, d’une carrière ou d’un apprentissage universitaire. Un accès original aux coulisses de la recherche en France comme ailleurs dans le monde, et aux rapports d’altérité qui se construisent en enquête. Vivre pleinement son ethnographie conduit souvent à s’adapter aux contextes étudiés, à s’impliquer dans la cité, parfois à militer, tout en interrogeant sa propre biographie et sa responsabilité éthique.
Le directeur et la directrice du volume
Anthropologue, Patrice Cohen est professeur des universités au département de sociologie de l’université de Rouen Normandie et chercheur au Dysolab. Ses thèmes de recherche privilégiés concernent l’alimentation et la santé, ainsi que leurs articulations, avec des terrains à l’île de la Réunion, en Inde du Sud, et en France hexagonale. Il dirige actuellement un axe socioanthropologique du projet pluridisciplinaire du programme ANR ALIMNUM (Alimentation et numérique, 2021-2025). Il a notamment publié Le cari partagé. Anthropologie de l’alimentation à la Réunion (Karthala, 2000) ; dirigé l’ouvrage Figures contemporaines de la santé en Inde (L’Harmattan, 2009) et coécrit Cancer et pluralisme thérapeutique. Enquête auprès des malades et des institutions médicales en France, Belgique et Suisse (L’Harmattan, 2015).
Ethnologue, Anne Monjaret est directrice de recherche au Laboratoire d’anthropologie politique (CNRS-EHESS). Elle codirige la collection « Ethnographies plurielles » aux Presses universitaires de Paris Nanterre et depuis 2024, elle est membre de la direction éditoriale collégiale de la revue Images du travail, travail des images. Ses travaux portent notamment sur les cultures, mémoires et patrimoines professionnels, féminins et urbains. Elle développe également une réflexion sur la pratique de l’ethnographie. Parmi ses dernières publications : La pin-up à l’atelier. Ethnographie d’un rapport de genre (Créaphis Éditions, 2020) ; avec Marie-Pierre Gibert, Anthropologie du travail (Armand Colin, 2021) et en direction d’ouvrage : Carrières (Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019).
- Des ethnographes engagé·e·s, sous la direction de Patrice Cohen et Anne Monjaret, PURH, 394 p., 15 €, ISBN :979-10-240-1876-8.
Avez-vous pensé à vous inscrire à la newsletter des PURH ?
Pour ne manquer aucune publication : abonnez-vous et recevez régulièrement par courriel l’ensemble des nouvelles entrées dans le catalogue.
Demandez votre inscription en écrivant à purh@univ-rouen.fr
Mazarin et les pays du Nord
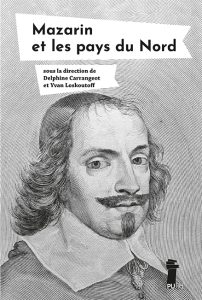
L’ouvrage
Formé par les Barberini, s’affichant Romain dans sa propagande, Mazarin cultiva ses liens méridionaux. Il fut aussi un homme du Nord, dans l’ordre politique comme dans celui de la culture. Dans l’ordre politique, sa lutte contre les Habsbourg impliqua l’Europe nordique notamment par les traités de Westphalie. Contraint à l’exil par la Fronde, il se réfugia à Brühl en Rhénanie. Dans l’ordre culturel, sa bibliothèque était aussi une « bibliothèque nordique » largement alimentée en Allemagne. Quant aux achats d’art, ils incluaient évidemment l’Europe du Nord (tableaux, tapisseries, curiosités), à commencer par les acquisitions lors de la vente des collections de Charles Ier d’Angleterre.
La directrice et le directeur du volume
Delphine Carrangeot est normalienne, agrégée d’histoire et maîtresse de conférences en histoire moderne à l’université Paris-Saclay. Elle est spécialiste d’histoire politique et culturelle des XVIe et XVIIe siècles, en particulier des représentations royales et princières dans l’Italie de la Renaissance et la France du Grand Siècle, ainsi que des rapports entre collectionnisme et politique dans l’Europe moderne. Elle a récemment dirigé Artistes et collections royales et princières en France (XVIe-fin du XVIIIe siècle) (Presses du Septentrion, 2025) et avec Bruno Laurioux et Vincent Puech, Rituels et cérémonies de cour, de l’Empire romain à l’âge baroque (Presses du Septentrion, 2022).
Yvan Loskoutoff, docteur et agrégé, est professeur de littérature française des XVIe et XVIIe siècles à l’université Le Havre Normandie. Il étudie les rapports entre littérature et spiritualité et entre littérature et symbolique. Il a publié cinq livres, dont Rome des Césars, Rome des Papes. La propagande du cardinal Mazarin (Honoré Champion, 2007, grand prix de l’Académie des sciences morales et politiques), une centaine d’articles et une dizaine d’actes de colloques, notamment avec Patrick Michel Mazarin, Rome et l’Italie, partie 1 : Histoire et partie 2 : Histoire des arts (PURH, 2021-2022).
- Mazarin et les pays du Nord, sous la direction de Delphine Carrangeot et Yvan Loskoutoff, PURH, 334 p., 18 €, 979-10-240-1893-5.
Retrouvez sur la webtv des PURH, sur le portail de l’URN, des interviews inédites
Marcello Vitali Rosati nous explique l’importance des « petites mains » dans les pratiques éditoriales dans son livre C’est la matière qui pense. Pour une philosophie de l’édition.
Emmanuelle Fantin et Julien Tassel reviennent sur la genèse et les thématiques de leur ouvrage collectif Quand l’enfance rencontre l’histoire. Imaginaires, représentations et savoirs, dans la collection « Littérature de jeunesse et histoire ».
Myriam Odile Blin et Pierre Albert Castanet présentent, avec leurs deux points de vue de sociologue et de musicologue, le dernier ouvrage de la collection « Arts dans la mondialisation » : Musiques, mondialisation et sociétés.
John Barzman raconte son cheminement de chercheur et ses principales sources au cœur de son ouvrage Les dockers du Havre, de la Révolution à nos jours.
À découvrir sur : https://webtv.univ-rouen.fr/channels/presses-universitaires-de-rouen-et-du-havre.
Date de publication : 06/11/25
